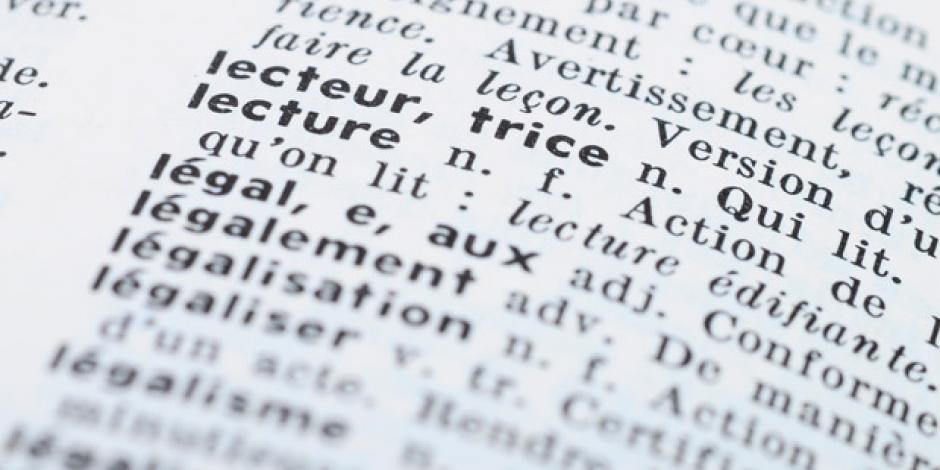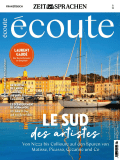En octobre 2014, à l’Assemblée nationale, le le députéder Abgeordnetedéputé Julien Aubert s’adresse à Sandrine Mazetier, la la présidente de séancedie Vorsitzendeprésidente de séance : « Madame le président… » aussitôtsogleichAussitôt, Julien Aubert reprendrezurechtweisenest repris, mais il persiste à dire « madame LE président ». Il finira par sanctionnerbestrafenêtre sanctionné ! Pendant ce temps, à l’école, les élèves continuent d’apprendre la règle de grammaire selon laquelle le masculin l’emporter surstärker sein alsl’emporte sur le féminin. Donc, si dans un groupe de 100 personnes, il y a 99 filles et un garçon, il faut employer le pronom personnel « ils ». Absurde, non ? Certains termes de la langue française relever degleichkommenrelèvent du sexisme. Pourquoi avoir gardé le mot « mademoiselle » alors que sa forme masculine « le damoiseauder Galan, der Knappedamoiseau » a disparu depuis longtemps ? Un exemple de discrimination homme/femme, mais aussi femme mariée/non mariée et une image stéréotypée du sujet féminin. Certains mots mis au féminin ont aussi une connotation sexuelle : un « professionnel » est un expert, alors qu’une « professionnelle » désignerbezeichnendésigne souvent une prostituée.
La langue de Molière sait se montrersich erweisen alsse montrer injuste avec les femmes. Mais cela n’a pas toujours été le casdas war nicht immer socela n’a pas toujours été le cas. Avant le XVIIe siècle, le masculin ne l’emportait pas sur le féminin. La règle de la proximitédie Näheproximité appliqueranwendenétait appliquée : l’adjectif accorderangleichenétait accordé avec le le nomdas Substantivnom le plus proche. On disait, par exemple : « des jours et nuits heureuses », ou bien : « que les hommes et les femmes soient belles ».
Est-ce uniquement une question de langue ? pas forcémentnicht unbedingtPas forcément. Au Québec, on parle des « droits de l’l’humaindie MenschlichkeitHumain », et une femme qui écrit des romans est une « écrivaine ». En France, on parle des « droits de l’Homme », et selon l’Académie française le mot « écrivaine » est une « l’aberration (f)die Verirrungaberration lexicale ». Encore aujourd’hui, l’Académie française refuse de reconnaître certains noms féminins de métiers comme professeure, auteure ou ingénieure. C’est donc aussi une affaire culturelle et nationale.
La volonté de mettre un terme à qcetw. beendenmettre un terme à tous ces sexismes se fait de plus en plus ressentir. En 2015, la publication d’un « Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe » a d’ailleurs rencontrer un grand succèsviel Erfolg habenrencontré un grand succès. N’oublions pas que c’est la langue orale qui modifie la langue écrite. Si, au quotidien, tout le monde parle sans discrimination de sexe, alors le français écrit finira par devenir plus égalitaire.
Neugierig auf mehr?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit und stellen Sie sich Ihr optimales Abo ganz nach Ihren Wünschen zusammen.